Le syndrome de l’imposteur chez les artistes émergents : quand le doute devient compagnon de création
Le syndrome de l’imposteur touche de nombreux artistes, qu’ils soient émergents ou confirmés. Doutes, légitimité, pression de réussir seul·e : ce malaise silencieux a des causes profondes, mais aussi des solutions. Dans cet article, on explore ses origines, son lien avec les milieux créatifs, et les 5 profils décrits par Valerie Young pour mieux comprendre et avancer.
LIFESTYLE
6/2/20253 min temps de lecture
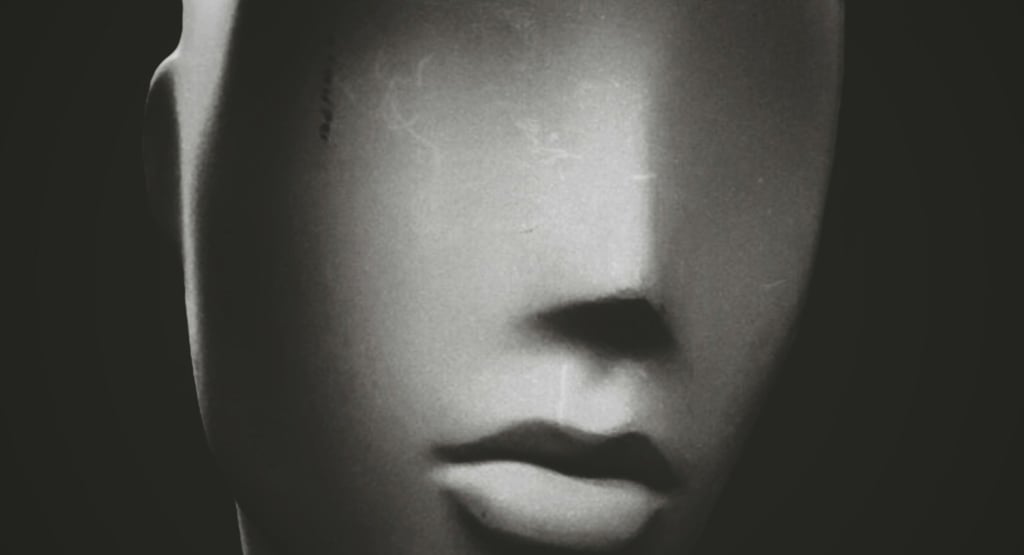
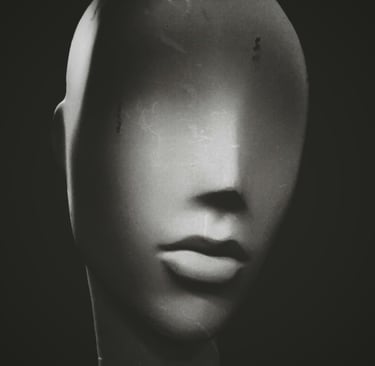
Un poison silencieux mais répandu
Chez les artistes, le syndrome de l’imposteur n’est pas un murmure : c’est un brouhaha intérieur constant. Un sentiment d’illégitimité qui s’accroche même (et parfois surtout) quand le succès pointe le bout de son nez. Ils vendent, ils exposent, ils performent… mais doutent encore. Ils se disent qu’ils ne sont « pas de vrais artistes ». Qu’ils ont eu de la chance. Qu’un jour, tout le monde découvrira l’imposture.
Ce phénomène touche plus de créateur·ices qu’on ne l’imagine. Une étude menée en 2020 par l’Université du Québec à Montréal a révélé que plus de 70 % des étudiant·es en arts visuels déclaraient avoir souffert, à un moment ou un autre, de ce sentiment d’illégitimité. Plus troublant encore : ce chiffre ne diminue pas forcément avec les années ou les réussites.
D’où vient ce syndrome ?
Le terme a été popularisé dans les années 1970 par les psychologues Pauline Clance et Suzanne Imes. Elles observaient alors ce phénomène chez des femmes à haut potentiel, persuadées d’avoir trompé leur entourage sur leurs compétences. Aujourd’hui, on sait que ce syndrome traverse les genres et les milieux, mais il semble avoir une affinité particulière avec les métiers artistiques, pour plusieurs raisons.
D’abord, parce que l’art n’a pas de baromètre objectif de réussite. Il n’y a pas de note, pas d’examen final, pas de diplôme qui légitime pleinement une carrière. Ensuite, parce que le processus de création implique une mise à nu constante, où chaque œuvre devient le reflet (incomplet et vulnérable) d’une identité. Enfin, parce que le monde de l’art, souvent opaque, valorise des récits d’exception et de “génie”, laissant peu de place à l’erreur, à l’apprentissage, au tâtonnement.
Une génération plus exposée ?
Avec l’essor des réseaux sociaux, ce sentiment est accentué. Instagram, TikTok et consorts imposent un culte de la visibilité immédiate, où l’artiste est sommé d’être à la fois créatif·ve, community manager, curateur·ice et entrepreneur·se. L’œuvre n’est plus seulement jugée : elle est “likée”, “swipée”, classée, parfois en quelques secondes.
Et derrière cette pression numérique se cachent des doutes récurrents : “Pourquoi lui, pas moi ?”, “Est-ce que mon travail a une valeur s’il ne buzz pas ?”, “Et si mes abonnés se rendent compte que je n’ai aucune idée de ce que je fais ?”
Apprivoiser le doute, ne pas le fuir
Il serait illusoire de croire que ce syndrome peut disparaître. Mais il peut être apprivoisé, intégré comme une composante du parcours créatif. Beaucoup d’artistes le vivent, et nombreux·ses sont ceux·celles qui ont appris à transformer ce doute en moteur plutôt qu’en frein.
Valerie Young, experte internationale du syndrome de l’imposteur et autrice de The Secret Thoughts of Successful Women, souligne que ces sentiments sont particulièrement fréquents dans les domaines créatifs. Elle explique que les artistes sont souvent jugés selon des critères subjectifs, ce qui peut exacerber le sentiment d’imposture.
Young identifie également cinq types de “profils d’imposteurs” : le perfectionniste, l’expert, le génie naturel, le solo et le super-héros. Chacun de ces profils a des attentes irréalistes envers lui-même, ce qui alimente le sentiment d’imposture.
Et si c’était normal ?
Peut-être faut-il simplement dire que oui, le doute fait partie du métier. Qu’il est même, parfois, le signe d’une conscience aigüe de la responsabilité créative. Car les vrais imposteurs, ce sont souvent ceux qui ne doutent jamais.
Et si vous vous sentez comme un imposteur… c’est peut-être que vous êtes, justement, un·e vrai·e artiste.
Sources :
• Clance, P. R., & Imes, S. A. (1978). The Impostor Phenomenon in High Achieving Women: Dynamics and Therapeutic Intervention. Psychotherapy: Theory, Research & Practice.
• Étude UQAM, Département d’arts visuels (2020) : enquête qualitative sur les sentiments d’illégitimité chez les étudiants en création.
• Young, V. (2011). The Secret Thoughts of Successful Women: Why Capable People Suffer from the Impostor Syndrome and How to Thrive in Spite of It. Crown Publishing Group.
• Impostor Syndrome Institute : https://impostorsyndrome.com
